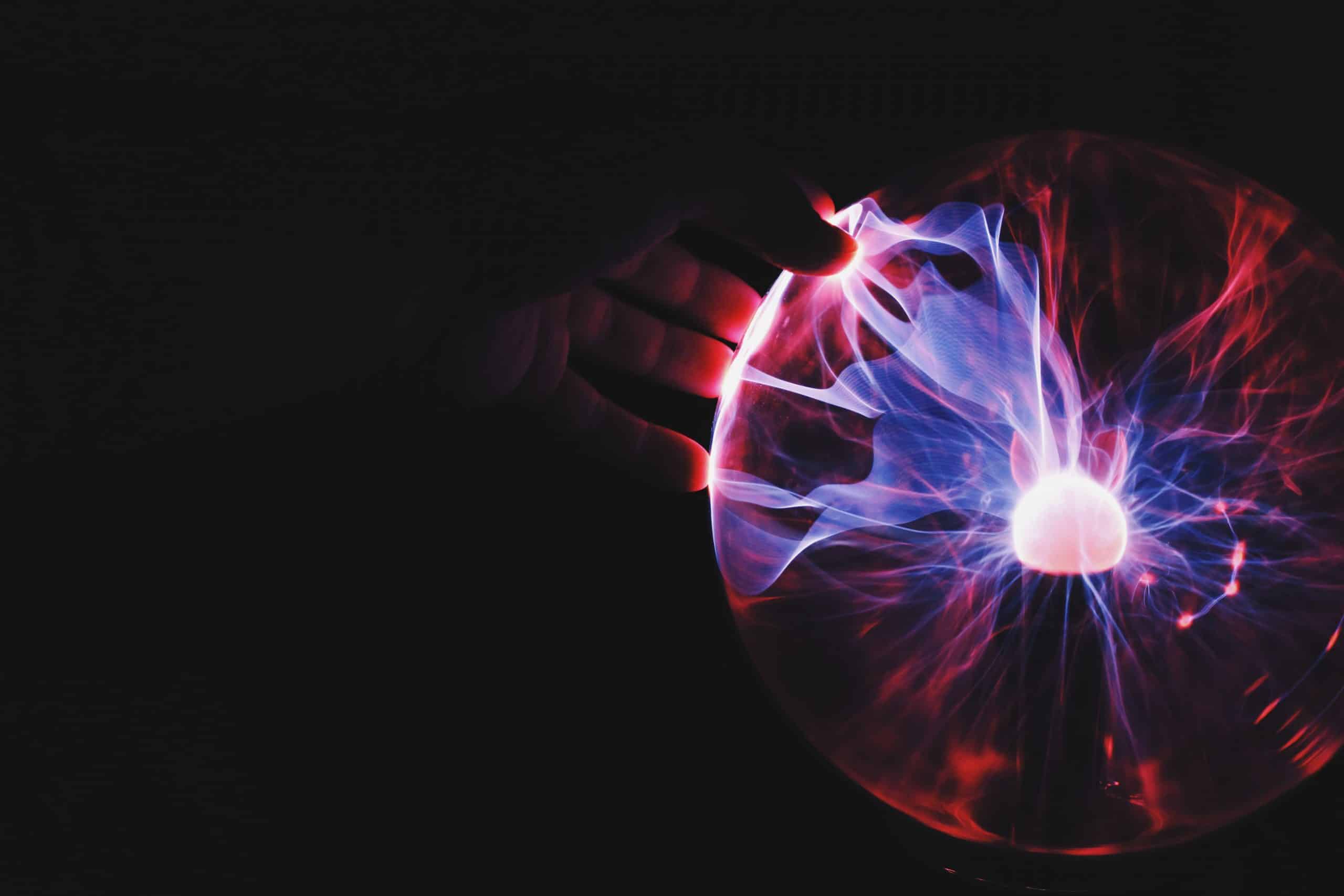L’innovation redéfinit tout. Elle fait même de défauts des qualités. Avec elle, le déséquilibre, l’aléa, l’inattendu deviennent des moteurs puissants pour de nouvelles façons d’inventer, de travailler, de penser, de collaborer. Pourtant, l’instabilité a aussi ses limites : celles de l’acceptabilité sociale, sociétale, et tout simplement humaine. Il faut alors trouver un équilibre entre le « toujours plus » et le « toujours mieux »
L’innovation est étonnante : elle redéfinit tout. Parmi les redéfinitions opérées par la logique qu’elle instaure, il y a la transformation de problèmes en vertus ou de défauts en qualités. L’inattendu et l’instabilité font par exemple partie de ces catégories profondément réinterprétées. Elles faisaient partie de ce qu’il fallait éliminer pour progresser, elles sont au contraire devenues les conditions de l’avancée. L’inattendu était quelque chose qui intervenait en quelque sorte pour se mettre en travers dans des process super régulés, comme ceux de l’industrie, par exemple. Là, il n’y avait ni inattendu, ni instabilité – en tout cas, ils étaient assimilés à la promesse de mauvaises surprises, et tout visait donc à les contenir dans des limites supportables par le système, quel qu’il soit. Ils représentaient l’aléa, donc l’ennemi à combattre. La rationalité était ce qui tendait à triompher de l’inattendu et de la surprise : dans une organisation complètement rationnelle, l’inattendu et son corollaire l’instabilité, devaient autant que possible être bannis. Ces notions sont aujourd’hui ce que l’innovation oblige à rechercher.
Mais, dans le modèle de fonctionnement et de pensée qui est le nôtre, elles ont changé de signification. Il ne s’agit plus de la même instabilité ni du même inattendu. L’inattendu, compris comme l’aléa qu’il faut réduire, s’est transformé au profit d’un inattendu, entendu au sens du surprenant qui génère plaisir et profit, et qu’il faut donc rechercher. L’instabilité, quant à elle, de problème est devenue un avantage. Et même un avantage compétitif décisif ! Aujourd’hui, elle est la marque de systèmes capables d’évoluer, d’organisations ou de modes de pensée qui savent ne pas être enfermées dans leurs certitudes, de process qui parviennent à éviter la momification dans leurs façons de faire.
Échouer pour mieux réussir
La recherche fondamentale, sur laquelle reposent de nombreuses innovations, est le règne de l’inattendu. Par principe, pour trouver quelque chose de neuf, il ne faut pas savoir dès le départ de quoi il s’agit précisément. On ne sait littéralement pas où l’on va. Une grande découverte scientifique part souvent d’une vague intuition, ou même d’une sensation. Et n’est d’ailleurs pas forcément le résultat de ce qui était recherché. C’est ainsi que peut se frayer un chemin mental nouveau susceptible de déboucher sur une découverte.
L’innovation est en phase avec cette ouverture qui permet à la nouveauté d’advenir. Elle laisse aussi place à la possibilité que rien de neuf ou d’exploitable n’advienne sans que ce soit un problème. Car, comme en recherche fondamentale, il est fréquent que l’on ne trouve rien au bout d’un chemin que l’on pensait prometteur, et la découverte émerge bien souvent d’une bifurcation après une série d’échecs. Ainsi, l’innovation offre une part positive à l’échec. Quand il est bien géré, celui-ci prépare à l’inattendu de la découverte et de la nouveauté. Steve Jobs disait qu’il ne faisait vraiment confiance qu’à des gens qui avaient connu l’échec. Le fondateur d’Apple déclarait d’ailleurs engager prioritairement des collaborateurs qui avaient su se remettre d’une absence de réussite et apprendre de leurs échecs.
Agilité et tenségrité
Cette primauté de l’instabilité et de l’inattendu est liée à la prise de conscience relativement récente par l’industrie des vertus créatrices du déséquilibre. C’est fondamentalement ce que désigne ce marqueur d’adaptation à l’innovation, ce signe de souplesse et d’acceptation du mouvement, qu’est l’agilité.
Le mot « agile », tel qu’il est employé aujourd’hui vient du monde de l’informatique, précisément du Manifeste agile, rédigé en 2001 par des experts en développement de logiciels. « Agile » désigne une nouvelle façon de se comporter et de travailler, qui utilise à plein les qualités de l’instabilité et du déséquilibre. Cette nouvelle approche se caractérise par l’accueil du changement, et non pas la résistance contre lui, le travail collectif, la dimension humaine, le choix du lien direct, la préférence pour la simplicité, et la confiance dans l’auto-organisation et la rétroaction des résultats sur les process. Ce nouveau pragmatisme repose essentiellement sur le fait d’accepter d’être en déséquilibre avec ses propres certitudes. Être agile, c’est prendre pour essentiel ce qui semblait accessoire (ou problématique) au système précédent : le désordre, le hasard, la remise en question à n’importe quel stade, l’interaction, etc. L’acceptation des variations (de contexte, de talents, de circonstances, etc.), et leur utilisation comme force dynamique est la base de ce nouveau réalisme. Ce mode de fonctionnement est un mode d’équilibre qui vient du déséquilibre. Celui-ci vient du fait que les points de forces ne passent plus seulement par les individus, mais aussi par ce qui se passe entre eux. Plus souple, ce mode d’organisation favorise les conditions de la découverte de la nouveauté.
Cette approche fait écho à d’autres champs, comme l’architecture par exemple. En donnant une importance centrale à la tenségrité, l’architecte, designer et inventeur Richard Buckminster Fuller a pu créer d’immenses dômes géodésiques dans les années 50. La tenségrité (= tensile integrity, qui peut se traduire par « intégrité par tension ») fait que les éléments d’un tout ne tiennent que parce qu’ils sont en tension les uns avec les autres. Là aussi, règne un équilibre à base de déséquilibre. La surprise, le côté inattendu de ces structures vient du fait qu’on ne comprend pas facilement comment elles tiennent, car la force vient non pas des choses, mais de l’échange de forces entre les choses, une fois celle-ci mise en tension. Dans les collectifs de travail adoptant ces méthodes, l’unité et la force se font grâce aux échanges collaboratifs, créateurs de tensions positives entre les personnes.
Gérer le déséquilibre
Pourtant, tous les déséquilibres ne sont pas désirables. Fondée sur l’instabilité, l’innovation génère aussi de l’instabilité : l’un des aspects problématiques est donc l’absorption des cycles de changement.
L’innovation doit prendre en compte le différentiel entre la rapidité du progrès et les capacités d’adaptation des êtres humains. Bien qu’immenses et progressant sans cesse (notre capacité à intégrer la nouveauté a littéralement explosé ces 30 dernières années avec Internet et le numérique), celles-ci ne sont pas pour autant extensibles à l’infini. Ces capacités sont par ailleurs inégalement réparties : il y a une injustice de répartition des facultés adaptatives selon les individus. Selon les structures mentales, la position sociale, l’âge, la culture, etc., les uns et les autres ne réagiront pas de la même façon à la nécessité de s’adapter. Cette question recoupe, comme beaucoup, une logique générationnelle. Les référentiels de la plupart des personnes de 40 ans et plus, qui travaillent dans les entreprises souvent à des postes de responsabilité, sont encore modelés sur l’idéal de stabilité et de chasse à l’inattendu (dans le cadre du travail en tout cas). Contrairement à la génération Y ou Z, qui a grandi dans cette instabilité, et dont elle fait pleinement partie de la culture, la plupart de leurs réflexes sont conditionnés sur ces éléments désormais obsolètes, et évidemment inadaptés à la nouvelle situation. Ce qui oblige ces personnes à recaler leurs réactions, comme s’il fallait opérer en permanence une réinitialisation mentale. Ce n’est pas spontané. Cela occasionne souvent une dépense d’énergie psychique importante. Cette dépense excédentaire permet peut-être d’expliquer en partie l’augmentation des cas de burn-out dans les organisations.
Suivant une logique qui semble déconnectée de la prise en compte de ses conséquences, notamment sociales et sociétales, la rupture, et l’instabilité qui l’accompagne, peuvent sembler trop rapides ou trop fortes. Car l’écart entre vitesse de progression de l’innovation et capacités d’adaptation s’accroît chaque jour un peu plus.
Se pose alors la question des limites humainement et socialement acceptables à ces états permanents de déséquilibre. Sous couvert d’instabilité et d’inattendu peut-on tout se permettre ? Évidemment, non. Un tel état où rien n’est fondamentalement stable, s’il semble naturel et désirable à un entrepreneur de la tech dans la Silicon Valley, peut sans doute apparaître comme négatif et potentiellement porteur de souffrance à quelqu’un vivant d’un travail dans une industrie classique où, comme une épée de Damoclès, plane la menace d’ubérisation.
Une façon de maîtriser cette question est de développer un sens aigu des responsabilités de chacun sur les actions et les initiatives : il y a donc les droits, mais aussi les devoirs. Les politiques RSE des entreprises, autant que les nouvelles logiques collaboratives qui valorisent l’initiative au sein des groupes de travail, prennent davantage en compte les apports de chacun. Elles posent de façon nouvelle la question d’un emploi porteur de sens, et sont sans doute pour cette raison de bonnes façons de développer la perception de faire partie intégrante de ce modèle en évolution constante. Dans tous les cas, il est nécessaire d’accompagner la rupture, de faire comprendre sa logique. Il faut expliquer et inclure le plus possible. Sans quoi l’instabilité peut gagner le social, et favoriser l’adhésion à des discours réactifs ou réactionnaires qui promettent à tort un fantasmatique retour à la stabilité. Il est donc très important de travailler à la baisse d’anxiété, de fébrilité et d’angoisse générées par l’état général d’instabilité. Car, malgré tout, les êtres humains ont aussi besoin de stabilité. Il est donc utile de faire comprendre que malgré le déséquilibre recherché, des garde-fous sont toujours présents.
Innover pour le bien commun
Si sa mise en œuvre est la plupart du temps d’une forte complexité, le principe de l’innovation est au fond très simple : c’est dans le même geste créer et détruire. À la fois positive et négative, l’innovation est bifide : elle crée un nouveau produit, un nouveau service, un nouvel usage ou une nouvelle façon de faire ou de produire. Parallèlement, sa nouveauté peut détruire les formes d’organisation qui lui préexistaient, car elles se révèlent à l’évidence moins performantes. Ainsi, pendant qu’elle crée des activités, des besoins, de la valeur, une innovation va supprimer des métiers et des emplois, donc anéantir de la valeur. Ce double impact, positif et négatif, a parfois lieu sur des pans entiers de la société. En fait, l’innovation concerne désormais l’ensemble de la société : soit par la nature d’une innovation particulière, soit par la logique de l’innovation qui s’étend aujourd’hui à tout l’espace social et à tous les aspects de l’existence.
Ainsi, loin de se réduire à l’interprétation technologique du terme, l’innovation est politique. Et c’est en tant qu’objet politique qu’elle pourrait être envisagée, à la fois pour mieux profiter de ses bénéfices, et pour se prémunir de ses possibles dérives.
L’instabilité positive offerte par l’innovation manque souvent d’alignement avec l’instabilité sociale qu’elle est susceptible de générer. Une innovation, surtout si elle est majeure, advient dans un environnement la plupart du temps peu apte à la recevoir – comme si l’on voulait pratiquer un nouveau sport sur un terrain ancien pas adapté. Lorsque l’on considère l’arrivée d’une innovation, il est donc important de prendre en compte aussi bien ses créations que ses destructions, et, avant de la plébisciter, d’en estimer, dans la mesure du possible, le coût économique, mais aussi social.
En tant que telle, même si cette proposition est susceptible de faire sauter au plafond (de verre) les tenants d’une innovation totalement décorrélée de la prise en compte de ses conséquences, l’innovation pourrait sans doute faire l’objet d’un plus grand contrôle sur son acceptabilité politique et sociale. Une innovation qui, à travers un saut technologique, apporte un bien économique – fût-il gigantesque – au prix d’un malheur social mérite-t-elle d’être qualifiée d’innovation ? Telle est la question qui pourrait être posée et largement débattue par toutes les parties prenantes, y compris les consommateurs de l’innovation.
Jusqu’à présent, peut-être n’a-t-on fait qu’effleurer la qualité d’inattendu dont l’innovation est porteuse. Celle-ci n’a sans doute pas accouché de tout le bénéfice dont elle est capable. En réalité, sa principale véritable valeur ajoutée se joue sur le terrain du social, du sociétal et de la RSE. Tout l’enjeu de l’innovation serait alors de concourir à une certaine idée du bien commun. Si l’innovation fait rêver de manière illimitée, il ne tient qu’à nous que le « toujours plus » bascule vers un « toujours mieux ».
Article initialement paru dans LaTribune